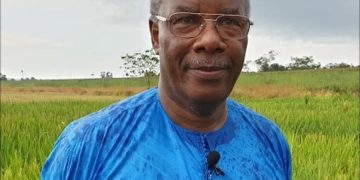Le Lac Tchad est sur le point d’être couvert par le cadre juridique de la Convention sur l’eau, à la suite de la confirmation par le Niger de son souhait d’accéder à ladite Convention, a annoncé jeudi la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).
Cette adhésion à venir à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux constitue « une étape décisive » pour la région puisque qu’elle rendra alors le Lac Tchad entièrement couvert par le cadre juridique de la Convention.
En effet, en devenant Partie, le Niger rejoindra les pays riverains du Lac Tchad à savoir le Tchad et le Cameroun devenus Parties respectivement en 2020 et en 2022 et le Nigéria, en passe de devenir Partie.
« L’adhésion prochaine du Niger à la Convention sur l’eau confirme l’intérêt politique grandissant à travers le monde pour la coopération transfrontalière sur les ressources en eau partagées », a déclaré dans un communiqué, Sonja Koeppel, secrétaire de la Convention.

Le Niger partage 90% de ses ressources en eau avec ses pays limitrophes
Cette annonce de Niamey intervient à quelques jours de la conférence sur l’eau des Nations Unies qui se tiendra du 22 au 24 mars 2023. Selon Mme Koeppel, celle-ci offrira d’ailleurs l’occasion d’avancer sur ce sujet notamment dans le cadre du dialogue interactif dédié à l’eau pour la coopération. « Ceci est important sachant que plus que 60% des ressources en eau se trouvent dans les bassins transfrontaliers », a-t-elle ajouté.
Rejoindre la Convention sur l’eau permettra au Niger de consolider cette coopération existante avec ses pays voisins, en facilitant notamment la mise en place de ces cadres juridiques régionaux. « La Convention sur l’eau constitue un cadre juridique dont la mise en œuvre, en complément des cadres régionaux et des instruments nationaux, et contribuera certainement à appuyer les efforts de notre pays en matière de coopération transfrontalière sur nos bassins partagés, la prévention des conflits, la promotion de la paix et l’intégration sous- régionale », a affirmé le ministre nigérien de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Adamou Mahaman.
Le Niger partage 90% de ses ressources en eau avec ses pays limitrophes. L’augmentation rapide de la demande en eau est liée à la croissance démographique de ce pays, qui compte 25 millions d’habitants et un taux de croissance annuel de la population de près de 4%.
Il y a aussi l’urbanisation, l’intensification de l’agriculture irriguée et l’industrialisation grandissante, qui font peser des défis de plus en plus importants sur les ressources hydriques partagées du pays. L’exacerbation de ces défis a récemment entraîné une plus grande dépendance vis-à-vis des ressources en eau souterraine.
Une raréfaction de l’eau due aux effets du changement climatique
Par ailleurs, la durabilité de ces ressources est également menacée par les effets du changement climatique. Dans un tel contexte, la coopération transfrontalière représente un outil nécessaire pour relever certains de ces défis – en offrant un espace de discussion entre pays riverains pour identifier des solutions conjointes.
À cet égard, le Niger a déjà signé plusieurs accords sur ses ressources partagées comme la Charte de l’eau du bassin du Lac Tchad. De plus, le Niger est également membre de l’Autorité du bassin du Niger et de la Commission du bassin du Lac Tchad, organismes de bassins incontournables de la région.
Au-delà du cas nigérien, la vulnérabilité climatique du Sahel se traduit par des épisodes de grande sécheresse et des pluies variables, rendant la région tantôt confrontée à des pluies diluviennes et des inondations, tantôt à des pluies insuffisantes. Selon la CEE-ONU, la raréfaction de l’eau menace les moyens d’existence de millions de personnes qui vivent en majorité de l’agriculture pluviale et de l’élevage.

17 pays africains veulent adhérer à la Convention sur l’eau
Au cours des dernières décennies, la concurrence pour la terre, l’eau et la nourriture s’est intensifiée dans la région, entraînant une recrudescence de l’instabilité, notamment autour du Lac Tchad et dans le bassin du fleuve Niger.
« L’adhésion progressive de plus en plus de pays de la région à la Convention sur l’eau va contribuer à prioriser politiquement la question de la gestion des ressources en eau à travers le renforcement de la coopération au niveau politique et technique- en prenant en compte également les interactions inhérentes qui existent entre l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire et l’instabilité régionale », a fait valoir l’agence onusienne.
La Convention fournit également une base solide pour aider à mobiliser des financements et à réduire les risques d’investissement dans les infrastructures hydrauliques. C’est dans ce contexte que la dynamique mondiale en faveur de la Convention sur l’eau se renforce, notamment en Afrique où 90% des eaux de surface sont situées dans 63 bassins transfrontaliers, et 40% du continent est situé sur des aquifères transfrontaliers.
Après l’adhésion à la Convention depuis 2018 par le Tchad, le Sénégal, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Togo et le Cameroun, 17 pays africains leur emboiteront le pas. Il s’agit du Bénin, du Botswana, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, du Congo, de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, de la Namibie, de la Sierra Leone, de la Tanzanie, de la Tunisie, de l’Ouganda et de la Zambie.
- Selon la CEE-ONU, la Côte d’Ivoire, la Gambie et le Nigéria sont en phase avancée d’adhésion